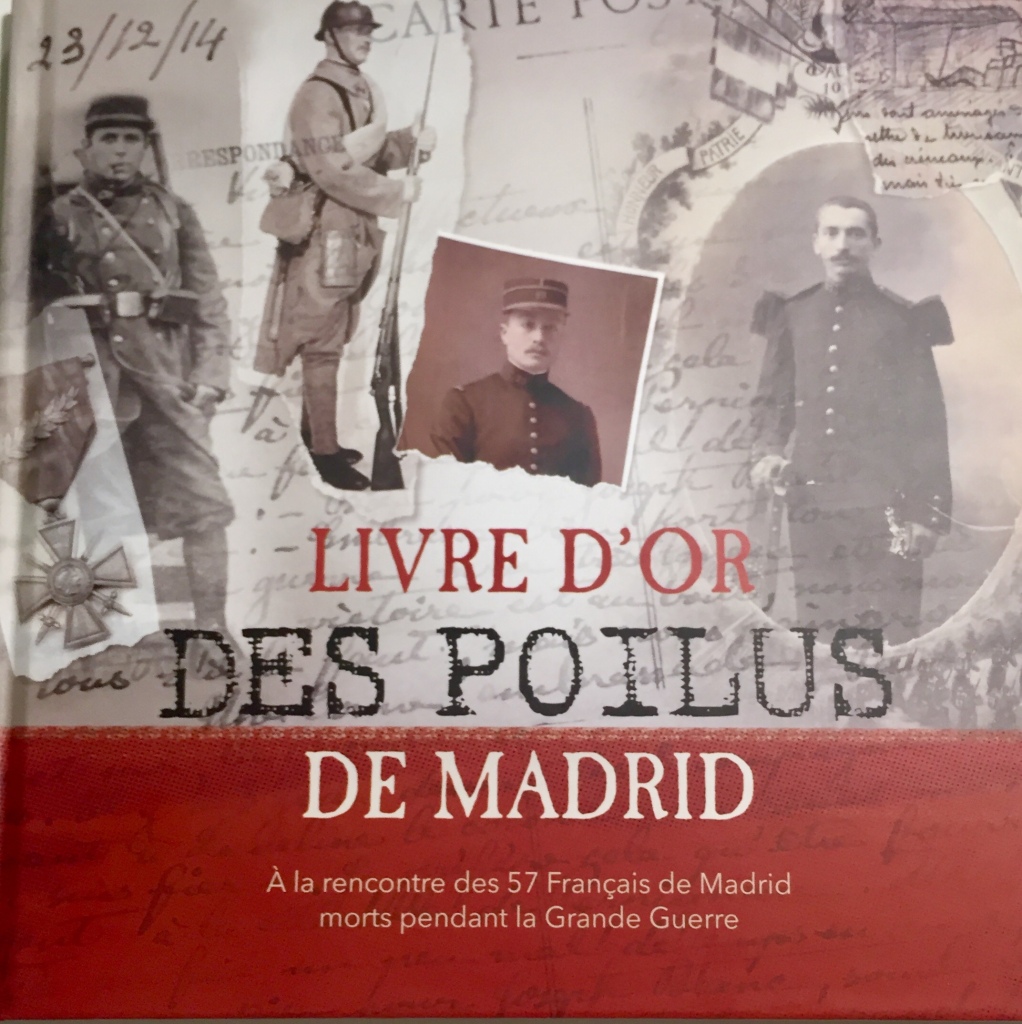VICTIME DE L’ARTILLERIE FRANÇAISE
par Raffi Hanifa, parent d’élève du Lycée français de Madrid
Employé de commerce originaire du Cantal, Marius Lagarde est venu s’installer à Madrid, où il a vécu deux ans avant d’être mobilisé. Engagé dans les combats avec le 92ème, puis le 146ème régiment d’infanterie, il a été de toutes les grandes batailles de la première moitié de la guerre.
Né le 16 mai 1888 à Jaleyrac, petite commune rurale du Cantal, Jean Paul « Marius » Félicien Léon Lucien Vital Lagarde grandit au sein d’une famille de deux enfants. Son père, Jean, est marchand ambulant en Belgique. Avec son frère Antoine, de deux ans son aîné, ils sont donc élevés par leur mère Justine, restée au village. Les deux enfants suivent l’instruction obligatoire à l’école primaire. Si Antoine termine sa scolarité sachant lire et écrire, Marius, lui, suit une instruction primaire plus poussée : il est employé de commerce quand il est appelé sous les drapeaux.
De Clermont-Ferrand à Madrid
Marius est déclaré « Bon pour le service » en 1909. Il est affecté au 92ème régiment d’infanterie (R.I.) de Clermont-Ferrand, le 8 octobre. Il y effectue un service sans histoire, seulement marqué par le décès de son père en 1910, se voyant accorder le certificat de bonne conduite à son départ en 1912. C’est alors qu’il communique à l’administration son intention de s’installer à Madrid. Il y restera deux ans. Employé de commerce, il habite au 137 calle de Alcalá, à deux pas des anciennes arènes de la calle Goya – aujourd’hui le Palais des Sports de Madrid – et du parc du Retiro, dans un quartier alors en pleine expansion urbanistique. Mobilisé au tout début d’août 1914, il retrouve le 92ème R.I. de Clermont-Ferrand. Son destin personnel se confond alors avec celui de son régiment, et c’est à travers les historiques du 92ème et du 146ème R.I. que l’on peut suivre sa trace dans la Grande Guerre.
Plongé dans la guerre de mouvement
Au 92ème R.I., la mobilisation est complète le 7 août, et le 9, Marius et ses camarades sont déployés dans les Vosges. Le 12, ils font mouvement vers la frontière à la rencontre des Allemands qui l’ont déjà franchie, et les premiers combats se produisent le 14, les forçant à se replier. Ils passent à leur tour la frontière, à leur poursuite. Mais à partir du 20 août jusqu’au 2 septembre, pris sous le feu allemand et subissant de lourdes pertes, ils doivent battre en retraite. À leur tour harcelés par l’ennemi, les Français se battent au corpsà- corps dans les Bois de Ramberviller, au nord-est d’Épinal, chef-lieu des Vosges. Marius et son régiment sont relevés, puis débarqués le 15 septembre dans l’Oise. À partir du 20, ils prennent pleinement part aux combats de la bataille de la Marne. Du 20 au 30, fixés par l’artillerie allemande, à court de munitions, ils doivent défendre leurs positions à la baïonnette. Privés de l’appui de l’artillerie française qui manque d’obus, ils subissent de lourdes pertes face à l’infanterie adverse et sont finalement relevés.
De la Belgique à la Somme
Envoyés en Belgique le 12 novembre, Marius et ses camarades sont engagés à Ypres, dans le secteur de Broodseinde. Ils y combattent furieusement jusqu’au 1er décembre, faisant face à l’artillerie et aux mitrailleuses allemandes, et ils s’y distinguent par leur combativité. Mais les pertes sont lourdes. Désengagés courant décembre, ils sont ramenés dans la Somme, où ils passeront l’année 1915 à se remettre en conditions. Mais la fin de l’année les voit reprendre le combat dans les secteurs du Bois des Loges et de Beuvraignes où Marius est blessé au pied. Le 25 décembre, il est déclaré inapte au service pour une durée de deux mois. Il se remet de sa blessure, pendant que ses camarades s’entraînent au camp de Crèvecoeur, et tous repartent fin février pour écrire une nouvelle page dans l’histoire de la guerre.
Rescapé de l’enfer de Verdun
Placés en réserve dans les bois, sous la neige, par -12ºC et à court de nourriture, Marius et son régiment reçoivent le 7 mars l’ordre de reprendre le Bois des Corbeaux aux Allemands. L’attaque a lieu le lendemain. Remontant à découvert 900 mètres sous une pluie d’obus et les tirs des mitrailleuses, ils reprennent le bois. Mais privés de l’appui de l’artillerie française aveuglée par la neige, ils passent les jours suivants à repousser les contre-attaques ennemies. Face à l’ampleur des pertes, ils sont relevés le 10 mars : Marius survit à l’enfer de Verdun, contrairement à 1 500 de ses camarades qui y laissent la vie.
L’ultime combat dans la Somme
Le régiment, décimé, est chargé de tenir le secteur de Fouquescourt, à une vingtaine de kilomètres de Montdidier où stationne le 146ème d’infanterie qui se prépare pour la bataille de la Somme. Marius y est transféré le 1er mai. Marius et son nouveau régiment arrivent à Méricourt-sur-Somme le 1er juin. Ils y passent tout le mois à préparer l’offensive franco-britannique qui vise à percer les lignes allemandes. Celle-ci est déclenchée le 1er juillet. Placé en réserve, le bataillon de Marius n’y participe pas directement les premiers jours. Mais le 8 juillet, il est en première ligne avec pour objectif la prise de Hardecourt. Malheureusement, victime d’une erreur de tir de l’artillerie française, la compagnie de Marius doit se replier, poursuivie par l’ennemi. C’est au cours de cette journée confuse que Marius trouve la mort, en même temps que 48 de ses camarades. Porté disparu, son corps n’a pas été retrouvé. Son nom figure sur le monument aux morts de Jaleyrac, sa ville natale, et dans le livre d’or du ministère des pensions de cette même ville.
La guerre des artilleurs
Lors des conflits précédents, les pertes au combat étaient dues pour les deux tiers aux armes légères. En 1870, le fusil Chassepot français est même responsable de 80% des pertes prussiennes. Dès 1914, la situation change. L’artillerie devient responsable de cette même proportion de morts au combat, provoquant la terreur dans les rangs adverses, mais également dans son propre camp en raison de fréquentes erreurs de tir. Qu’elle soit de campagne, lourde ou de tranchée, l’artillerie connaît un essor exponentiel pendant le conflit, et avec une consommation proche de 300 000 obus par jour pour la seule armée française, au moment de la mort de Marius. Face à un tel déluge, les usines de fabrication d’obus se multiplient. Là, malgré le danger, 400 000 femmes, appelées les “munitionnettes”, participent à l’effort de guerre dans ce qui représente leur première intégration massive au marché du travail.